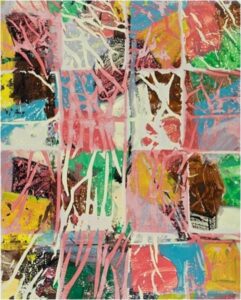À l’occasion de l’émission du vendredi, au cours de laquelle Avec philosophie a coutume de puiser une question ou un problème dans l’actualité récente, Géraldine Muhlmann, avec Éric Marty et Benoît Peeters, vous proposent de réfléchir à la question du « Neutre » à partir du cours du Collège de France donné en 1978 par Roland Barthes.
Ce cours fait l’objet d’une réédition inédite aux éditions du Seuil : Roland Barthes, Le Neutre. Cours au Collège de France (1978), édité, préfacé et annoté par Éric Marty, éditions du Seuil, avril 2023.
Une mise entre parenthèses
Le neutre n’est jamais atteint de manière définitive, il est une démarche à reprendre, à redésirer. Pour Eric Marty, en effet, « le neutre est une tradition très ancienne, profonde et diverse ». Il en retrouve la trace dans les courants taoïstes et zens, mais également chez les sceptiques et stoïciens grecs. Il s’agit d’adopter « des positions de sécession, d’opposition ou de recul », de « créer une forme de distance, de mise entre parenthèses des opinions dominantes ». De fait, rappelle le philosophe, » Barthes n’invente pas le neutre ». Au contraire, il s’inscrit dans une longue tradition « pulsionnelle » de la pensée. Comme dans le neutre, il y a toujours spontanément, dans la pensée, « un recul par rapport à elle-même, et un recul par rapport au sens ».Barthes n’invente pas le neutre ». Au contraire, il s’inscrit dans une longue tradition « pulsionnelle » de la pensée. Comme dans le neutre, il y a toujours spontanément, dans la pensée, « un recul par rapport à elle-même, et un recul par rapport au sens ».
L’importance de l’écoute
Benoît Peeters explique qu’il existe chez Barthes le « désir d’une parole vraie », d’une « parole contemporaine de lui-même ». Ainsi, si la pensée du philosophe a beaucoup évolué, et est même passée par « des périodes d’arrogance scientifique », il y a, dans les derniers moments de sa vie, une idée importante : « être à l’écoute ». De fait, « il passe d’un discours de l’ordre du savoir et de la théorie à une recherche permanente d’un bien vivre », qu’il cherche à communiquer aux auditeurs de ses cours. Barthes « nous entraîne alors dans quelque chose de très inattendu », remarque Benoît Peeters : « au fond, nous n’apprenons pas énormément, mais nous pensons, nous réfléchissons, nous sommes emmenés à travers les idées et les concepts ».
Éric Marty, écrivain, universitaire et éditeur de plusieurs œuvres de Roland Barthes, notamment les Œuvres complètes (5 volumes, éditions du Seuil, 2002). Il a établi l’édition définitive du Cours au Collège de France dispensé par Barthes sur la question du Neutre : Roland Barthes, Le Neutre. Cours au Collège de France (1978), éditions du Seuil, avril 2023.
Il a notamment publié :
Benoît Peeters, écrivain et scénariste. Il a préparé le diplôme de l’EPHE sous la direction de Roland Barthes.
Il a récemment publié :
Références sonores
Avec philosophie remercie chaleureusement les Éditions du Seuil d’avoir transmis de rares enregistrements du cours du Collège de France donné en 1978 par Roland Barthes.
- Archive de Roland Barthes, cours du Collège de France donné le 18 février 1978
- Archives de Roland Barthes, cours du Collège de France donné le 3 juin 1978
- Archive de Lila Braunschweig, auteure de Neutriser, Emancipation(s) par le neutre (éditions Les Liens qui libèrent, 2021), une interview menée par Manon de La Selle et Sam Baquiast, le 5 juin 2023
- Chanson de fin d’émission : Chris et Indochine, « 3e sexe » (2022), reprise du titre de 1985 d’Indochine